- Accueil
- Biographie d' Édouard Lartet (1801-1871)
Biographie d' Édouard Lartet (1801-1871)
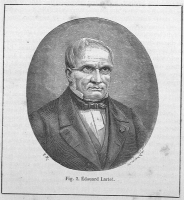 Édouard Amant Isidore Hippolyte Lartet naît le 15 mai 1801 dans la paroisse de Saint Guiraud, aujourd’hui commune de Castelnau Barbarens (Gers). Excellent élève au Lycée impérial d'Auch – Napoléon le récompense lors de son passage en 1808 –, il est bachelier à 18 ans, et part étudier à la Faculté de Droit de Toulouse où il est reçu avocat en 1820. Extraordinaire coïncidence, c'est Georges Cuvier, le plus influent paléontologue de son temps mais alors aussi conseiller d'État, qui signe son diplôme à la place du Ministre de l'Instruction publique. Après avoir effectué un stage pratique à Paris, il revient dans le Gers pour y exercer sa profession d'avocat au château d'Ornézan, propriété familiale. Il effectue alors à Sansan, petit village des environs, ses premières découvertes de fossiles, qui lui vaudront une grande notoriété. En 1840, il épouse Léonide Barrère qui donne naissance à leur fils Louis en décembre. En 1852, soucieux que Louis, qui vient d’entrer au Lycée, reçoive une bonne formation, il s'installe à Toulouse, mais repart deux ans plus tard à Paris.
Édouard Amant Isidore Hippolyte Lartet naît le 15 mai 1801 dans la paroisse de Saint Guiraud, aujourd’hui commune de Castelnau Barbarens (Gers). Excellent élève au Lycée impérial d'Auch – Napoléon le récompense lors de son passage en 1808 –, il est bachelier à 18 ans, et part étudier à la Faculté de Droit de Toulouse où il est reçu avocat en 1820. Extraordinaire coïncidence, c'est Georges Cuvier, le plus influent paléontologue de son temps mais alors aussi conseiller d'État, qui signe son diplôme à la place du Ministre de l'Instruction publique. Après avoir effectué un stage pratique à Paris, il revient dans le Gers pour y exercer sa profession d'avocat au château d'Ornézan, propriété familiale. Il effectue alors à Sansan, petit village des environs, ses premières découvertes de fossiles, qui lui vaudront une grande notoriété. En 1840, il épouse Léonide Barrère qui donne naissance à leur fils Louis en décembre. En 1852, soucieux que Louis, qui vient d’entrer au Lycée, reçoive une bonne formation, il s'installe à Toulouse, mais repart deux ans plus tard à Paris.
Dès lors, et pendant les deux dernières décennies de sa vie, Édouard Lartet s'intéresse au problème de l'homme fossile, et poursuit de nombreuses fouilles d’abord dans les Pyrénées puis dans la vallée de la Vézère, en Dordogne. Ces travaux lui offriront une consécration nationale et internationale qui lui vaudra, en 1869, d’être nommé professeur de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il ne pourra cependant pas donner de cours : affecté par des problèmes de santé, il se retire définitivement dans sa ferme de La Bernisse où il meurt le 29 Janvier 1871, jour de l'entrée des troupes de Guillaume Ier dans Paris.
L'homme de Sansan
La carrière scientifique d’Édouard Lartet commence véritablement avec la découverte du site paléontologique de Sansan. En 1833, Joseph Debat, un berger qui exploite la petite métairie du lieu dit Le Campané, lui amène en remerciement de quelques conseils juridiques une dent de Mastodonte. Cette dent provient d'un endroit que les gens du pays ont surnommé "lo camp de los ossos" tant il est fréquent d'y récolter des ossements lors des labours. Curieux, Édouard Lartet se end sur le site et entreprend des fouilles qui livrent très rapidement quantité de fossiles. Dès 1834, il communique le résultat de ses travaux à la Société géologique de France. Modeste, il s'excuse d'utiliser "quelques termes scientifiques sans en connaître toute la portée", arguant que "les débris organiques [sont] un sujet tout à fait étranger à [ses] études primaires". En réalité, Lartet, lors du stage d'avoué qu’il avait effectué à Paris, s’était formé auprès ses maîtres du Muséum national à une discipline alors naissante. Il avait acheté et revendu, sur son modeste budget d'étudiant, les ouvrages traitant de ce sujet, et consacré tous ses loisirs à l'étude de la littérature et des sciences. L'importance des découvertes effectuées à Sansan convainc immédiatement Guizot, ministre de l'Instruction publique, de lui allouer des fonds pour exploiter le site. Au mois de décembre 1836, Lartet fait une découverte qui met en émoi toute la communauté scientifique : une mâchoire de singe fossile. Il l'étudie soigneusement et rend compte de ses travaux à l'Académie des Sciences le 16 janvier 1837. Alors que la notion d'Évolution est ébauchée par le Transformisme de Lamarck, cette découverte arrive à point nommé. Cuvier, décédé trois ans plus tôt, n'avait-il pas affirmé que les singes fossiles n'existaient pas ? Les partisans de l'évolution exultent, les adversaires poussent des hauts-cris. Une commission d'enquête présidée par Henri Ducrotay de Blainville est diligentée. Elle doit se rendre à l'évidence : l' avocat gersois a raison. Si Isidore Geoffroy Saint-Hilaire affirme "La découverte de la mâchoire fossile du singe de M. Lartet me paraît appelée à commencer une ère nouvelle du savoir humanitaire", Lartet enfonce le clou : "l'existence paléontologique de l'homme est une supposition qui n'a rien d'invraisemblable". La chasse à l'homme fossile est véritablement lancée. Pendant une dizaine d'années, Lartet continue à étudier le site de Sansan. Il affronte l'administration pour obtenir des fonds, jusqu'à ce que le site soit acheté par l'État en 1847. Pour extraire les fossiles, il n'hésite pas à tamiser de grandes quantités de marnes durant près de trois ans. Il décrit finalement dans ce gisement de très nombreuses espèces qui représentent différents groupes zoologiques : insectivores, rongeurs, chiroptères, insectivores, carnivores, rhinocéros, suidés, cervidés et bovidés. Parmi les 78 espèces reconnues à Sansan, vingt-sept sont encore valides aujourd'hui (Ginsburg et Bulot, 2000).
Mais l'activité paléontologique de Lartet ne s'arrête pas au seul gisement de Sansan. En 1856, il publie notamment un article sur un primate découvert près de Saint Gaudens, Dryopithecus fontani, qui prendra place pendant quelque temps dans l'ascendance de l'homme et collabore avec Albert Gaudry à l’étude des faunes de Pikermi, en Grèce, et travaille sur le groupe de la famille des éléphants, les Proboscidiens.
Le préhistorien
Dans les années 1860, les centres d'intérêt d'Édouard Lartet se tournent vers la paléontologie humaine et la préhistoire. Depuis longtemps, s’il n'est pas à proprement parler un partisan de l'évolution et de l'origine simienne de l'homme, il croit en l'existence d'un homme très ancien, d’époque tertiaire. Il est proche des positions que défend De Blainville, selon lequel la création originelle est fort ancienne, et l'histoire de la vie relève d’un lent appauvrissement dont témoignent les fossiles. Pour Lartet en outre, les changements observés dans les couches géologiques attestent seulement des différentes migrations des espèces à la surface de la planète.
Lartet ne doute donc pas de l'existence paléontologique de l'homme et en recherche les preuves directes et indirectes. À nombre d'auteurs comme Tournal, on a opposé les problèmes de mélanges de couches dans les grottes. Lartet choisit donc de s'intéresser aux terrains sédimentaires du "diluvium" (c’est ainsi que, par référence au déluge biblique, on nommait alors les couches datant du Pléistocène) que des chercheurs comme Boucher de Perthes, avec lequel il est en contact très étroit, explorent méthodiquement. Alors que ne nombreux savants mettent en doute la contemporanéité des outils lithiques et des fossiles d'espèces disparues, Lartet démontre magistralement que de nombreux ossements portent des traces de découpe réalisées avec ces outils lithiques, maniés de main d'homme. La preuve de l’ancienneté de l’Homme est ainsi faite. Pour autant, Lartet se heurte aux convictions profondes d’Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, qui refuse de publier son article et n'en mentionne guère que le titre dans Les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Lartet, furieux, fait paraître le résultat de ses travaux en Angleterre, puis en Suisse, avant qu'enfin ils soient diffusés en France, dans les Annales des sciences naturelles.
Entre temps, Édouard Lartet a souhaité réaliser ses propres fouilles. Il débute en 1860 par la grotte de Massat, en Ariège. Mais c’est avec l’abri d’Aurignac en Haute-Garonne, qu’il commence à explorer en octobre 1860, dix huit ans après la découverte du site par un ouvrier terrassier nommé Bonnemaison, que Lartet va écrire une nouvelle page de la Préhistoire. Il y était venu attiré par les squelettes humains découverts par Bonnemaison, mais ceux-ci ont entre temps disparus (sans doute ont-ils été inhumés dans la fosse commune du cimetière paroissial). En dépit de cette déception, c’est en paléontologue avisé qu’il profite de ses travaux pour établir la première bio-chronologie relative de la période préhistorique. Il la divise en quatre ensembles, caractérisés par des animaux emblématiques, même s’il émet quelques réserves sur ces distinguos stratigraphiques : l’âge de l’ours des cavernes, l’âge de l’éléphant et du rhinocéros (du mammouth et du rhinocéros laineux), l’âge du renne et l’âge de l’auroch. Il faudra attendre les travaux de Gabriel de Mortillet et le développement de la typologie des outillages en pierre et en os pour dresser une vision plus précise de la chronologie préhistorique. Les observations de Lartet à Aurignac seront toutefois reprises ultérieurement et elles serviront notamment à l’abbé Breuil, en 1906, pour caractériser la première culture préhistorique du Paléolithique supérieur, l’Aurignacien.
Par la suite, Lartet se consacre, aux côtés de son ami et mécène britannique Henri Christy, à l’exploration autour des Eyzies-de-Tayac de la vallée de la Vézère, qui révèle au monde des sites majeurs comme Le Moustier, La Madeleine, Laugerie ou Gorge d’Enfer. En 1864, Lartet découvre dans l’abri de La Madeleine une des pièces majeures de l’art mobilier : une gravure de Mammouth sur un fragment de défense du même animal, preuve définitive, s’il en était encore besoin, que l’homme était bel et bien contemporain des espèces disparues. Louis Lartet, fils d’Édouard, est quant à lui chargé d’étudier les restes de l’homme de Cro-magnon, découverts en 1868. Grâce à l’ensemble de ses découvertes et observations, Lartet sera à juste titre considéré comme l’un des principaux fondateurs de cette science nouvelle, la préhistoire, et les collections qu’il lègue à plusieurs institutions, dont le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, resteront longtemps des références incontournables.
F. Duranthon, Ph. Gardère , d’après l’article publié dans : Le Muséum de Toulouse et l’invention de la préhistoire, Ed. du Muséum de Toulouse, 2010
Tout Découvrir
-
Antoine Darquier de Pellepoix, l’observation du ciel à Toulouse au 18e siècle
[Focus] -
Figures de plantes : le souci (calendula officinalis)
[Focus] -
Une parodie de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ?
[Focus] -
Bonne année... et surtout la santé !
[Focus] -
Joyeux Noël !
[Focus] -
Des bibliothécaires et archivistes d'Occitanie mènent l'enquête dans leurs fonds anciens
[Actualités] -
Images à découvrir : Tous en selle avec Tolosana !
[Focus] -
Et Toulouse pour apprendre : François Bayle, persona non grata à la faculté de médecine de Toulouse
[Focus] -
Images à découvrir : "les mille choses curieuses" de l'Introduction à l'Ecriture sainte par B. Lamy
[Focus] -
Deux dynasties d'imprimeurs toulousains qui soignent leurs images de marques
[Focus]
- 1 sur 11
- ›

